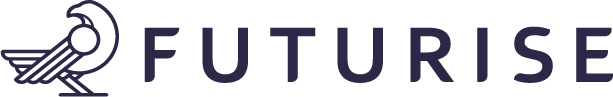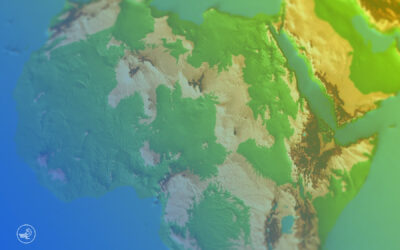Les Marchés de la Nature
Dans les deux premières chroniques de notre trilogie, nous avons montré que le Maroc fait face à un besoin de financement écologique estimé à plus d’un milliard d’euros pour préserver ses zones humides, forêts, littoraux et autres écosystèmes clés. Nous avons exploré les leviers innovants — Crédits Nature, Parts Nature — et proposé une structuration claire de ces marchés pour garantir leur crédibilité et leur transparence.
La question qui se pose maintenant est double. D’abord, comment créer un environnement d’incitation — fiscal, financier, réglementaire — qui attire acheteurs et investisseurs, sécurise la participation des acteurs locaux et assure un marché fluide et dynamique ? En d’autres termes, comment faire en sorte que le marché marocain des services écosystémiques devienne un plein succès ?
Ensuite, une fois ce socle national solide en place, comment capitaliser sur cette réussite pour projeter le Maroc comme hub vert de référence sur le continent africain ? Cela implique de transformer son ingénierie financière et institutionnelle en un outil d’influence stratégique. Ainsi le Maroc pourra fixer les standards, devenir la plateforme incontournable pour l’échange de Titres Nature africains, et utiliser cette position pour peser dans les équilibres géopolitiques régionaux.
C’est à cette articulation entre réussite nationale et rayonnement continental que cette troisième chronique prospective est consacrée.
Instruments d’incitation
Pour qu’un marché de la nature atteigne sa masse critique, il ne suffit pas de créer des Titres. Il faut bâtir un écosystème d’incitations capable de mobiliser investisseurs, entreprises et collectivités. Le succès dépend de la capacité à réduire les risques perçus, améliorer la rentabilité et donner un cadre clair et crédible aux transactions. Pour cela, le Maroc disposera de trois leviers : fiscal, financier et réglementaire.
Les mesures fiscales jouent un rôle déterminant pour déclencher la demande et encourager les premiers acheteurs :
- Exonérations temporaires pour les entreprises ou particuliers qui acquièrent des crédits biodiversité ou climat certifiés, afin de compenser le surcoût initial par rapport à des solutions moins vertueuses.
- Allégement ou suppression de la TVA sur les transactions liées aux crédits et parts certifiés, ce qui réduit mécaniquement le prix final et accroît l’attractivité du marché.
- Déductions fiscales ciblées pour les entreprises intégrant des crédits certifiés à leur bilan carbone ou à leur reporting ESG, permettant de transformer l’achat de Crédits Nature en avantage compétitif face aux obligations réglementaires futures.
Un marché émergent attire rarement les capitaux privés sans incitations financières et mécanismes de partage du risque. Parmi les mesures qui pourraient être mises en place citons notamment :
- La création d’un fonds marocain de capital-risque climatique, alimenté par l’État, les banques de développement et les investisseurs institutionnels. Ce véhicule financerait en priorité des projets pilotes de restauration et de conservation, en co-investissant aux côtés d’acteurs privés pour partager le risque et faciliter leur engagement.
- La mise en place de garanties publiques, sous forme de fonds de garantie ou d’assurance-crédit, couvrant une partie du capital investi en cas d’échec ou de performance inférieure aux objectifs. Ce dispositif permettrait de limiter l’exposition au risque et de renforcer la confiance des investisseurs institutionnels dans les projets de restauration et de conservation.
- L’émission d’obligations vertes — Green Bonds —, au niveau national ou par les collectivités locales. Celles-ci seraient destinées à financer des projets de protection et de restauration des écosystèmes. Le remboursement du capital et des intérêts pourrait être en partie indexé sur les revenus effectivement générés par la vente de Crédits ou de Parts Nature, alignant ainsi les intérêts des investisseurs avec la performance environnementale des projets financés.
Enfin, le cadre réglementaire devra donner confiance aux acheteurs tout en positionnant le Maroc comme une référence internationale en matière de finance verte. Pour cela, les mesures suivantes devront être envisagées :
- La création d’un label “Titre Nature Certifié” porté par une autorité nationale indépendante et reconnu par les instances internationales. Ce label garantirait la traçabilité, l’additionnalité et la pérennité des projets.
- L’intégration des Titres Nature dans la fiscalité climatique nationale, par exemple en permettant leur utilisation pour satisfaire une partie des obligations liées à une taxe carbone ou à des obligations de compensation écologique.
- L’alignement avec les standards internationaux — Global Biodiversity Framework, Science Based Targets for Nature — afin de faciliter la reconnaissance et la convertibilité des titres sur les marchés étrangers.
En associant ces trois leviers, le Maroc pourrait amorcer rapidement la demande, sécuriser l’offre et établir un marché robuste, capable ensuite de s’exporter comme modèle sur le continent.
Partenariats Sud-Sud, le Maroc comme hub vert africain
Le succès national des marchés de la nature n’est pas une fin en soi. Une fois la crédibilité acquise —grâce à des standards clairs, des mécanismes de certification robustes et une plateforme d’échange performante — le Maroc pourrait transformer ces acquis en leviers d’influence à l’échelle continentale.
L’objectif est double. Exporter son savoir-faire et fixer les règles du jeu. En diffusant ses outils de mesure, ses protocoles de certification et ses modèles de gouvernance, le Maroc pourrait non seulement créer un effet d’entraînement auprès de ses partenaires africains, mais aussi s’assurer que ces standards deviennent la référence commune. Cette « norme marocaine » constituerait alors un atout stratégique dans toutes les négociations régionales et internationales liées au climat et à la biodiversité.
Rappelons qu’il existe un précédent remarquable avec l’initiative régionale menée par l’OCP dans le domaine de l’agritech. Ce programme a démontré la capacité du Maroc à fédérer un écosystème diversifié d’acteurs — ministères, agences de développement, entreprises privées et centres de recherche — au-delà de ses frontières.
En s’appuyant sur ses positions établies au Maghreb et au sein de la CEDEAO, l’OCP a su bâtir des projets transnationaux à forte valeur ajoutée, mêlant innovation technologique, transfert de compétences et soutien direct aux agriculteurs. L’intérêt stratégique de cette démarche réside dans sa dimension intégratrice. Les différents pays partenaires ont pu harmoniser leurs approches, mutualiser certaines infrastructures et créer des canaux de financement communs. En renforçant ainsi la coopération économique et technique, ce modèle a non seulement accru l’efficacité des initiatives locales, mais aussi consolidé le rôle du Maroc comme catalyseur régional.
Transposé au domaine des marchés de la nature, ce type de partenariat pourrait offrir un cadre éprouvé pour bâtir une plateforme africaine interconnectée, où les Crédits et Parts Nature circuleraient dans un espace normatif cohérent et piloté par des standards de qualité reconnus.
Mais cette stratégie Sud-Sud devra dépasser le simple cadre de la coopération technique. Elle pourra également ambitionner de faire de la diplomatie climatique un levier d’influence régionale, en inscrivant la protection des écosystèmes et la finance verte au cœur des rapports de force économiques et politiques. En capitalisant sur son avance en matière de structuration des Marchés de la Nature, le Maroc pourrait se positionner comme l’interface incontournable entre l’Afrique et l’Europe pour les financements verts.
Ce rôle d’intermédiaire stratégique lui permettrait :
- D’orienter les flux financiers internationaux vers les projets africains les plus structurants, en s’assurant qu’ils répondent à des standards de qualité et de transparence élevés.
- D’accueillir et de gérer des fonds internationaux — qu’ils soient publics, privés ou mixtes — en devenant une plateforme d’investissement sécurisée et reconnue.
- De servir de centre de formation et d’expertise pour les équipes techniques et administratives des pays partenaires, favorisant le transfert de compétences et l’harmonisation des pratiques sur le continent.
En combinant cette fonction de hub financier, normatif et capacitaire, le Maroc ne se contenterait pas de soutenir la transition écologique africaine, il en deviendrait le chef d’orchestre, fixant les règles du jeu, attirant les investisseurs et pesant sur les négociations internationales liées au climat et à la biodiversité.
De la finance verte à la puissance verte
Avec cette troisième chronique, nous avons franchi la dernière étape du raisonnement amorcé dans notre trilogie :
- Dans la première, nous avions identifié l’ampleur du défi — un besoin de financement écologique supérieur à un milliard d’euros pour préserver les écosystèmes vitaux du Maroc. Nous avons décrit le fonctionnement des Titres Nature — Crédits et Parts — et établit que ces instruments pourraient combler le manque pour financer les efforts de conservation et de restauration du patrimoine écologique marocain (Voir la première chronique de la série).
- Dans la deuxième chronique, nous avons proposé un cadre opérationnel crédible pour les Marchés de la Nature — Nature Markets — garantissant la transparence, la traçabilité et la sécurité pour les acteurs et les investisseurs (Voir la deuxième chronique de la série)
- Dans cette troisième et dernière chronique de notre trilogie, nous avons montré comment le Maroc pourrait transformer cette architecture nationale en un instrument d’influence géopolitique, faisant de lui le hub africain des marchés de la nature, capable de fixer les standards, d’orienter les flux financiers et de former les futures élites techniques de la transition écologique.
Ce triptyque illustre la conviction que la transition écologique ne se gagnera pas uniquement sur le terrain des forêts, des zones humides ou des littoraux. Elle se gagnera aussi sur celui des institutions, des marchés financiers et de la diplomatie. C’est là que se jouera la capacité d’un pays à être prescripteur et non pas suiveur.
Mais un tel chantier ne sera pas isolé. Il devra s’inscrire dans un mouvement plus large de sécurisation stratégique des ressources critiques à l’échelle africaine, qu’elles soient naturelles —eau, sols, biodiversité — ou technologiques — données, innovations agritech.
Une prochaine étape pourrait consister à lier finance verte et souveraineté hydrique, en faisant de l’eau non seulement un bien vital, mais aussi un actif stratégique structuré sur le modèle des Marchés de la Nature. En d’autres termes, après avoir posé les bases d’un pouvoir vert, il s’agira demain de le consolider par un pouvoir bleu, avec la même ambition d’hégémonie normative et d’influence régionale.