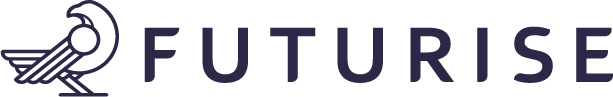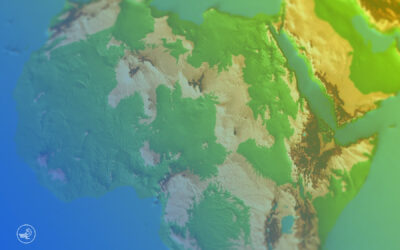Les Marchés de la Nature
Le Maroc se trouve à un moment clé pour la conservation et la restauration de son patrimoine naturel. Conscient que les financements publics ne suffiront pas pour sauvegarder ses zones humides, forêts, lagunes et littoraux menacés, il doit désormais explorer des mécanismes financiers qui sortent des approches traditionnelles.
Dans son dernier rapport, le think-tank Bruegel — Nature Markets: How can credits and shares provide durable, additional finance? – juillet 2025 — , imagine une solution aussi concrète qu’originale. Deux instruments financiers d’un genre nouveau pourraient changer la donne pour les pays comme le Maroc. Des unités écologiques certifiées appelées « Nature Credits » et des parts d’investissement liées à la régénération écologique, les « Nature Shares ». Ce modèle financier, appelé « Nature Markets » permettrait de mobiliser des capitaux privés tout en générant des dividendes environnementaux durables pour des montants bien supérieurs à ceux du modèle actuel —financement public et philanthropique.
Les initiatives comme BIOFIN — Biodiversity Finance Initiative — démontrent que les autorités marocaines sont bien conscientes des défis écologiques et de l’urgence de leur trouver une réponse financière crédible. Pourtant, malgré les efforts déjà engagés, l’économie du Royaume ne parvient pas encore à couvrir durablement le coût des services écosystémiques, qu’il s’agisse de la purification de l’eau au sein du parc national d’Ifrane, de la protection côtière assurée par la forêt de Mamora ou de la préservation des zones humides du Souss.
Cette chronique prospective — la première d’une trilogie — se propose donc d’examiner, dans un premier temps, l’état des lieux des principaux biotopes et écosystèmes marocains à protéger ou restaurer. Dans un second temps, elle explorera comment les « Marchés de la Nature » imaginés par Bruegel pourraient être adaptés au contexte national, avec la mise en place de Crédits et de Parts Nature pour combler le déficit de financement.
Etat des lieux de la biodiversité au Maroc
Le Maroc est riche d’un patrimoine naturel exceptionnel. Celui-ci joue un rôle vital dans la stabilité écologique, l’économie locale et la lutte contre le changement climatique. Voici un aperçu synthétique des principaux écosystèmes à fort potentiel pour la finance verte.
Des zones humides d’importance internationale
Le Maroc compte 38 sites Ramsar, couvrant plus de 316 000 hectares, incluant des lacs, des estuaires et des lagunes côtières essentiels à la régulation hydrique, à la biodiversité et au tourisme écologique. A titre d’exemple, le lac Afennourrir — 300 ha, à 1 800 m d’altitude — est inscrit au patrimoine Ramsar et rempli des fonctions écologiques majeures dans le parc national d’Ifrane.
Des forêts emblématiques
La forêt de la Mamora, plus grande surface de chêne-liège au monde — environ 130 000 ha —, est une réserve de biodiversité essentielle, un régulateur du climat et une protection naturelle contre l’érosion côtière. Au sud-est, le parc national d’Ifrane abrite des forêts de cèdres et des zones humides qui jouent un rôle essentiel dans la régulation de l’eau, la purification des écosystèmes et la prévention des inondations.
Des littoraux et des zones arides désertifiées
Le parc national de Souss-Massa — 33 800 ha — combine dunes, zones humides et habitats côtiers. Il abrite le rare ibis chauve et nombre d’autres espèces menacées. Ces environnements jouent un rôle primordial en matière de protection des zones rurales arides et des zones littorales.
Des écosystèmes agricoles
Les écosystèmes agricoles couvrent environ 8,7 millions d’hectares et abritent une biodiversité riche en variétés locales liées aux cultures et variétés traditionnelles. Celles-ci constituent un capital naturel crucial pour la stabilité alimentaire et un important moyen de défense face aux bouleversements climatiques.
En synthèse, le Maroc dispose d’un capital naturel d’une richesse rare, qui s’étend des zones humides du Nord aux forêts atlantiques, des littoraux méditerranéens aux oasis sahariennes, sans oublier ses écosystèmes agricoles diversifiés. Ces milieux assurent des services écologiques essentiels tels que la filtration et le stockage de l’eau, la régulation thermique naturelle, la préservation d’une biodiversité unique, la protection contre l’érosion, le maintien de la fertilité des sols et la production de cultures variées adaptées aux terroirs locaux.
Pourtant, ces services, bien qu’indispensables à l’économie et au bien-être des populations, restent encore largement invisibles dans les circuits financiers et budgétaires actuels. Leur valeur écologique réelle n’est ni pleinement valorisée ni correctement intégrée dans les décisions économiques, et ceci malgré l’existence de programmes structurants comme BIOFIN ou les plans nationaux pour la biodiversité.
C’est précisément ce déficit de valorisation qui appelle l’introduction d’outils nouveaux. Ces instruments sont capables de transformer le potentiel écologique du Royaume en véritables actifs financiers négociables. À travers les Crédits Nature et les Parts Nature, il devient possible de créer un pont entre conservation et marché, en faisant de la préservation des écosystèmes non seulement un impératif environnemental, mais aussi une opportunité économique et stratégique.
Les Marchés de la Nature — Nature Markets
Partout, les écosystèmes naturels déclinent à grande vitesse. Ceci menace la stabilité économique, climatique et sociale dans de nombreuses régions du Monde. Les financements publics ne parviennent pas à atteindre les 700 milliards $ par an nécessaires pour combler le déficit mondial de financement fixé par le Cadre Mondial sur la Biodiversité — COP 15 / Kunming‑Montréal.
Les « Nature Markets » constituent une réponse crédible à ce problème. L’idée est de créer des instruments financiers tradables, fondés sur des résultats écologiques vérifiables, et capables de canaliser des capitaux privés vers des actions environnementales à impact réel.
La solution repose sur deux instruments financiers conçus pour faire converger finance privée, conservation écologique et inclusion locale — les « Nature Credits » et les « Nature Shares ».
Les Nature Credits, des unités écologiques certifiables attachées à un résultat mesurable.
Ces « Crédits Nature » mesurent un service écosystémique concret et additionnel. Par exemple une tonne de carbone séquestrée, un hectare de forêt restauré, un habitat nouvellement protégé ou le retour d’une espèce localement éteinte. À la différence des crédits carbone ou des compensations traditionnelles, les Nature Credits sont vendus comme des preuves de restauration ou de conservation réelle, générant des dividendes environnementaux plutôt que des promesses compensatoires. Leur utilité est de permettre aux entreprises, institutions ou États de financer la nature non pas en prétendant « absorber » une malfaisance, mais plutôt en soutenant un résultat positif réel et mesurable sur la nature.
Les Nature Shares permettent d’investir dans la régénération écologique comme dans une entreprise.
Cet instrument financier, plus novateur encore, propose d’acquérir des parts d’un projet écologique. Ces « Parts Nature » sont émises le plus souvent par une autorité publique ou une structure consolidée — organisme public dédié, coopérative nationale ou groupement d’intérêt public. Les titulaires reçoivent des dividendes écologiques au fur et à mesure que le projet délivre ses résultats concrets — augmentation de la biodiversité, séquestration progressive, nombre d’hectares restaurés, etc. Cet instrument a un double intérêt. D’abord, il aligne la durée de l’investissement avec la durée de chaque projet — souvent de plusieurs décennies—, ensuite il permet la formation d’un marché secondaire — plus liquide — pour échanger des parts une fois l’échéance dépassée.
Les garde‑fous indispensables : rigueur, durabilité, responsabilité, inclusion.
Ces produits financiers ne peuvent être crédibles que si quatre principes structurants sont respectés dès leur conception. Le principe de rigueur scientifique d’abord. Les Crédits Nature et Parts Nature doivent être fondés sur des métriques écologiques fiables, appuyées sur des données et des méthodologies solides — télédétection, inventaires, images satellites, drones etc. Le deuxième principe est celui de la durabilité des bénéfices écologiques. Les résultats visés devront perdurer au-delà de 20 ans afin que les projets à impacts environnementaux éphémères ne soient pas privilégiés. Une gouvernance transparente devra être garante que le principe de responsabilité soit respecté. Il faudra une totale traçabilité des unités, la publication régulière d’indicateurs fiables et des audits indépendants récurrents pour éviter toute tentation de greenwashing. Enfin, le principe d’inclusion assurera la participation des communautés locales. Les populations vivant dans les zones concernées devront obligatoirement être incluses comme partenaires — et non simples bénéficiaires.
L’importance de l’additionalité et de la permanence
La principale faiblesse des marchés carbone tient à l’émission de crédits non additionnels et non durables. Dans le cas des « Natures markets », il faut éviter de commettre une nouvelle fois la même erreur. Un Crédit Nature doit viser un résultat qui ne se serait pas produit sans le projet —c’est le principe d’additionalité. En d’autres termes, il ne peut pas servir à « cautionner » une activité déjà en cours sans effet marginal réel. De même, les bénéfices doivent être contractuellement garantis dans le temps — c’est le principe de permanence —, notamment via des Obligations Réelles Environnementales — cas de la France — ou des servitudes à long terme. Enfin, des mécanismes comme l’émission « ex post » — après audit et vérification — ou des clauses de « clawback » —rétractation de crédits émis en cas de non-conformité — doivent être prévus.
Le succès des Nature Markets tient à l’évitement des dérives
Mesurer la biodiversité est complexe. La tentation des unités standardisées mais écologiquement vides pourrait à tout moment compromettre la valeur des instruments sur le marché. Seules des données fines, traçables et auditées permettent de garantir la qualité — et donc la confiance — des investisseurs et acheteurs. Enfin, le système devrait rendre possible la surveillance publique et citoyenne : registres publics, accès ouvert aux données, recours juridiques pour audits externes etc.
Le bilan est très clair. Le Maroc fait face à un déficit de financement pour la conservation qui pourrait atteindre plus d’un milliard de dirhams par an si l’on souhaite protéger tous ses écosystèmes prioritaires. C’est un budget largement hors de portée des financements publics et philanthropiques actuels. Il est donc urgent de créer des instruments financiers nouveaux pour transformer le potentiel écologique, aujourd’hui inerte financièrement, en un actif valorisable et échangeable. Cette chronique est la première — d’une série de trois — dédiée aux Marchés de la Nature.
Dans la chronique suivante, nous verrons comment structurer le marché concrètement. Comment initier des projets pilotes, créer une plateforme nationale des crédits, engager les communautés locales, garantir la transparence et l’intégrité ? Nous proposerons un modèle marocain permettant de monétiser l’écologie sans compromis, tout en soutenant la souveraineté et la place du Maroc dans la finance verte continentale.