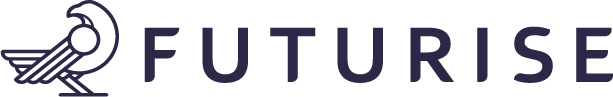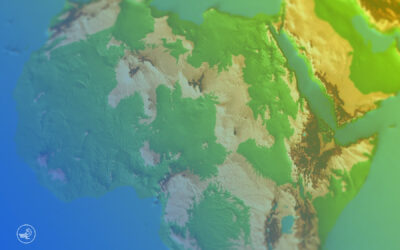L’Europe se trouve à un tournant critique. Elle ambitionne de faire de la finance verte le fondement de sa croissance, mais sans tenir compte des réalités économiques, cette ambition risque de la faire vaciller.
En 2023, les industries européennes ont payé des tarifs énergétiques nettement plus élevés que leurs concurrentes américaines. Dans ce contexte déjà difficile, l’application rigide des critères ESG — notamment l’exclusion pure et simple des entreprises encore dépendantes aux énergies fossiles — crée une double tension ; un exode des capitaux européens et une perte de contrôle sur des acteurs industriels engagés dans la transition.
Comment préserver la souveraineté industrielle européenne, maintenir la compétitivité de ses filières stratégiques et prolonger l’impact écologique souhaité au-delà des frontières de l’Union ? Pour répondre à cette triple question, cet article propose de nuancer la rigueur normative ESG, de dessiner un cadre pragmatique pour accompagner la transition et d’étendre cette ambition aux pays émergents, notamment en Afrique, pour construire une finance verte réellement porteuse d’influence.
Un désavantage structurel, la dépendance européenne au prix de l’énergie
Selon le think tank Bruegel, en 2023, les prix de l’électricité pour l’industrie étaient 158 % plus élevés dans l’UE que ceux des États-Unis, et les prix du gaz atteignaient +345 % dans la zone euro par rapport à l’Amérique du Nord.
Face à cette réalité, il est nettement plus difficile pour les grands groupes européens de créer un conserver un avantage concurrentiel face aux rivaux américains ou asiatiques. Et ce désavantage structurel est lourd de conséquences.
Selon une étude de Rabobank, les coûts unitaires de main d’œuvre dans l’industrie exportatrice de la zone euro sont presque 30 % plus élevés qu’aux États-Unis, ce qui pénalise fortement la compétitivité de ces entreprises. Il n’est donc pas anodin de voir les capitaux européens fuir vers les actifs américains, moins exposés à ces surcoûts et plus flexibles en matière d’innovation.
L’impact inattendu de la réforme ESG
Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, s’est fortement insurgé contre la réforme européenne des fonds ESG — Bloomberg—, qualifiant d’idéalisme excessif l’exclusion de toute entreprise générant plus de 1 % de ses revenus grâce au charbon ou 10 % grâce au pétrole. Cette vision « tout vert ou tout noir » pousse les fonds européens à vendre des titres, tandis que les investisseurs non soumis à ces contraintes (surtout américains) peuvent en profiter pour racheter ces actifs stratégiques à bas prix. Il y aurait donc, selon lui, un risque de bascule des piliers industriels européens sous le contrôle de puissances étrangères.
Dans un contexte où la zone euro peine déjà à retenir ses investisseurs, cette rigidité réglementaire pourrait ainsi accélérer l’exode des actifs stratégiques. De plus, ce désinvestissement idéologique pourrait paradoxalement pénaliser les entreprises qui investissent le plus dans la transition énergétique. Ainsi, selon un rapport d’ESMA et d’analystes du Morningstar, près de 1 600 fonds européens devraient vendre des parts d’entreprises à haut contenu carbone — pour un total estimé à 40 milliards USD — Financial Times.
Vers une stratégie ESG pragmatique ?
L’Europe aspire à être exemplaire sur le plan écologique, mais elle ne peut pas se permettre de sacrifier ses piliers industriels.
Pour résoudre cette délicate équation stratégique, trois pistes de réflexion :
- Nuancer les critères ESG selon les secteurs
La rigueur doit s’adapter aux réalités, certains secteurs doivent se voir accorder un délai de transition raisonnable, notamment l’énergie, l’agro-alimentaire, la chimie ou les transports. Ainsi, en allouant des marges de manœuvre temporelles et financières adaptées à chaque secteur, l’Europe préserve ses industries sans renoncer à ses objectifs ESG. Ce pragmatisme permettrait de conjuguer écologie et souveraineté industrielle, et permettrait que les entreprises puissent investir dans leur transition sans risquer d’être délaissées par les capitaux.
- Créer un label « Transition ESG »
Un label spécifique — soutenu par des critères transparents et adaptés aux réalités européennes — permettrait aux fonds de financer des entreprises en mutation sans exclure les acteurs n’étant pas déjà « totalement verts ». Ce concept s’inscrirait dans la logique émergente de transition finance, un segment du financement durable qui cible intentionnellement les secteurs à forte intensité carbone avec des plans de transition crédibles et vérifiables (Sustainable Futures). L’International Capital Market Association — ICMA—, avec son Transition Finance Handbook, insiste sur l’importance de critères sectoriels contextualisés et d’indicateurs robustes — jalons technologiques, seuils de performance, etc. De même, la plateforme européenne IPSF souligne la nécessité de décliner ces critères à l’échelle nationale ou régionale selon les réalités géographiques, économiques et technologiques.
Un label « Transition ESG », respectueux des seuils fixés par l’UE — CSRD, SFDR — mais plus nuancé, aiderait donc à retenir les capitaux européens tout en maintenant une pression sur la décarbonation.
- Favoriser les mécanismes de rétention régionale de capitaux
Plutôt que de laisser ces actifs stratégiques quitter l’Europe, l’Union, en partenariat avec ses partenaires africains, pourrait développer des plates‑formes de co‑investissement ou des fonds régionaux spécifiquement dédiés à la transition. Ces structures, où capitaux et risques seraient mutualisés, permettraient d’accompagner les entreprises en mutation sans sacrifier le contrôle national ou régional.
Cette troisième proposition s’inspire de dispositifs éprouvés :
- L’Africa Investment Platform de la BEI, est un instrument de financement mixte visant à soutenir les infrastructures en Afrique subsaharienne, en partenariat avec l’UE — ECFR
- Le Global Gateway Investment Package Europe‑Afrique, déployé par Team Europe, qui combine subventions et prêts pour accélérer la transition verte et numérique du continent — Commission Européenne.
Un tel dispositif présenterait un double bénéfice :
- Il permettrait à l’Europe de conserver un contrôle stratégique sur ses champions industriels tout en facilitant leur transformation ;
- Il engagerait ces mêmes acteurs dans la montée en compétence ESG des pays émergents, notamment africains. Les entreprises européennes pourraient ainsi s’implanter dans le cadre de partenariats solides, apportant leur savoir-faire en transition écologique.
Ce modèle favoriserait également le transfert de compétences vers les acteurs africains ce qui soutiendrait la solidarité Sud-Sud, le tout au service d’une ambition écologique réelle et globale.
L’enjeu va bien au-delà d’un simple débat idéologique. Il s’agit de sécurité économique, de puissance industrielle et de souveraineté politique.
La bonne nouvelle c’est que la réaction européenne ne devrait plus trop se faire attendre. La Commission planche en ce moment même sur un Clean Industrial Deal doté de capacités de financement, de soutien à l’énergie propre et de réduction des contraintes ESG pour les PME — The Wall Street Journal.
En conclusion
L’objectif n’est pas de nier l’importance des critères ESG, mais d’en faire un levier maîtrisé et mis au service de la souveraineté industrielle et économique. Sans cela, l’Europe risque de céder ses meilleurs atouts à des puissances étrangères plus opportunistes. Une stratégie ESG pragmatique, territorialisée et contextualisée est donc plus qu’opportune, elle est absolument indispensable.