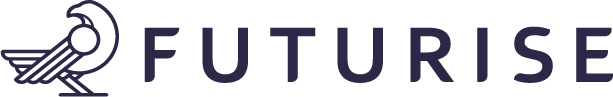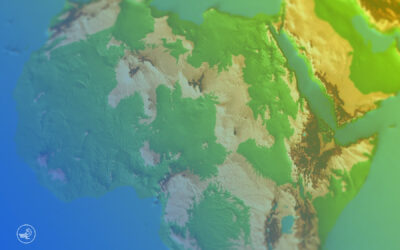Les Marchés de la Nature
Monétiser la nature sans la marchandiser, tel est le paradoxe qu’un futur Marché marocain de la Nature devra résoudre. Dans un pays soumis à une triple pression — climatique, économique et foncière —, bâtir un système de financement pour préserver les écosystèmes impose une architecture solide et crédible.
Le Maroc possède un patrimoine naturel exceptionnel et diversifié, mais l’inventorier ne suffit pas. Comme nous l’avons montré dans la première chronique de cette trilogie, les financements publics actuels ne couvrent qu’une fraction des besoins, estimés à plus d’un milliard d’euros. Pour combler ce déficit, le Royaume devra innover et mettre en place des instruments financiers comme les Crédits Nature ou les Parts Nature (Lire La finance verte comme opportunité stratégique pour le Maroc).
Encore faut-il que ces produits s’inscrivent dans un marché national structuré, où l’offre et la demande puissent se rencontrer dans un cadre propice. Cela suppose d’abord de concevoir un véritable marché marocain de la biodiversité, doté de règles, de standards et de procédures de certification solides. Il faudra ensuite déterminer comment organiser la gouvernance et mobiliser l’ensemble des acteurs — publics, privés et communautaires — autour d’objectifs clairs. Enfin, la réussite passera par un scénario de déploiement progressif, allant de projets pilotes bien ciblés à une montée en puissance nationale.
C’est cette dynamique — de la création du marché jusqu’à son fonctionnement opérationnel — que cette deuxième chronique prospective se propose d’explorer, avec un fil directeur : faire de la conservation de la nature un moteur économique, sans jamais céder à sa pure marchandisation.
Un marché marocain de la biodiversité
Un marché de la biodiversité repose sur un principe simple : permettre à des acteurs publics ou privés d’acquérir des « Crédits Nature » ou des « Parts Nature » représentant un effort concret, mesurable et vérifiable de protection ou de restauration de la nature — voir la première chronique de cette série pour une présentation détaillée de ces instruments.
Pour illustrer ce principe, prenons trois exemples parlants :
- Le Paiement pour Services Écosystémiques — PSE — constitue un bon cas de Crédit Nature. Ici, les gestionnaires d’écosystèmes — zones humides, agroforêts, zones côtières — perçoivent une rémunération contractuelle et régulière en échange de services environnementaux rendus à la collectivité : régulation des ressources en eau, préservation d’habitats rares, capture de carbone… Les versements sont conditionnés au respect d’indicateurs précis, mesurables et vérifiés par un organisme indépendant.
- Les Parts agro-pastorales illustrent une autre approche. Elles correspondent à des titres financiers matérialisant la valeur économique d’efforts de reforestation, de régénération de pâturages ou de maintien de pratiques agricoles durables, souvent portés par des coopératives locales. Ces parts peuvent ensuite être revendues sur un marché spécialisé ou servir de garantie pour accéder à des financements, créant ainsi un lien direct entre pratiques vertueuses et leviers économiques.
- Enfin, les Crédits de Restauration pourraient être développés au Maroc pour valoriser la réhabilitation mesurable de zones dégradées : terres arides, berges érodées, zones côtières en déclin. Chaque crédit attesterait de la restauration effective d’un hectare ou de la remise en état d’un service écologique précis, avec certification par un tiers indépendant pour garantir crédibilité et intégrité.
Ces exemples, parmi de nombreux autres possibles, montrent qu’il existe déjà des modèles concrets et adaptables pour transformer des efforts de conservation en véritables actifs financiers.
Dans un Marché de la Nature, les investisseurs ne se rémunèrent pas uniquement en dividendes ou en exploitation d’un actif comme dans un investissement classique, mais plutôt via la valorisation et la revente des Titres Nature qu’ils détiennent.
Voici comment cela fonctionne concrètement :
- Achat ou financement initial : Un investisseur apporte du capital pour financer un projet qui générera des Titres Nature — restauration de zones humides, reforestation. Ce financement peut être direct — prise de participation dans la société ou coopérative porteuse du projet — ou indirect — achat de Crédits Nature à prix préférentiel avant leur émission officielle.
- Génération et certification : Les actions menées sur le terrain — reboisement, protection d’habitats — sont mesurées et certifiées par un organisme indépendant. Chaque unité certifiée — par exemple un crédit émis pour la restauration vérifiée d’un hectare de forêt — devient un actif négociable.
- Valorisation et revente : L’investisseur revend ses Titres Nature sur un marché volontaire ou réglementé à des entreprises qui cherchent à compenser leurs impacts ou à améliorer leur score ESG. La valeur des Titres peut augmenter avec la demande — par exemple si les obligations réglementaires se renforcent ou si la rareté augmente.
- Autres sources de revenus possibles : Certains investisseurs peuvent aussi percevoir une partie des revenus issus de l’exploitation durable de la zone — écotourisme, récolte raisonnée, services écosystémiques payants. Dans le cas des Parts Nature — type equity — , il y a un retour sur investissement via les dividendes liés à l’activité économique générée par la zone restaurée ou gérée durablement.
Les gestionnaires d’écosystèmes sont rémunérés pour leurs services. Les investisseurs, eux, gagnent sur la valorisation et la revente de Crédits et Parts ou via les flux économiques générés par les projets.
Un cadre propice
Ces différents produits et instruments financiers ne pourront être réellement efficaces qu’à la condition que le marché puisse conserver durablement la confiance des investisseurs et des autres acteurs. Pour éviter les effets d’aubaine et le greenwashing — qui nuisent à la crédibilité du marché —, quatre piliers devront être assurés :
- Des standards nationaux clairs et transparents. Le Maroc devra définir des unités de mesure fiables — hectares restaurés, espèces cibles, durée d’engagement — et adopter une méthodologie de vérification conforme aux meilleures pratiques.
- Des acteurs de confiance pour l’émission des titres. Les Crédits ou Parts devront être émis par une autorité publique compétente — ministère, agence nationale —, ou une structure consolidée, comme une coopérative agréée ou un organisme public-privé reconnu. Ces entités joueront un rôle clé pour assurer la traçabilité, la gouvernance et la crédibilité des projets.
- Mettre en place un registre national centralisé. Celui-ci devra garantir la transparence des transactions, éviter le double comptage et assurer la traçabilité des Titres Nature et de leur durée de vie.
- Enfin, il sera impératif de mettre en place un encadrement juridique clair et transparent. Celui-ci permettra notamment de définir le statut juridique des Crédits et Parts, clarifier les droits des porteurs, prévoir des clauses de retrait — clawback — en cas de non-conformité, et encadrer la durée de validité des engagements écologiques.
Les acteurs et la gouvernance
Pour que ce Marché de la Nature fonctionne manière optimale, la gouvernance devra être claire, inclusive et articulée autour de responsabilités précises pour chaque acteur :
- L’État et les agences sectorielles telles que le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts, les Agences de bassins hydrauliques et MASEN seraient en première ligne pour fixer les priorités, délivrer les agréments et assurer la coordination nationale.
- Les collectivités territoriales, les communes rurales et zones sensibles — Rif, Moyen Atlas, Doukkala — joueraient un rôle d’identification des sites, de mobilisation des communautés locales et d’intégration des projets dans les plans de développement régionaux.
- Les ONG et coopératives, actrices de terrain dans le reboisement, la conservation communautaire et la gestion durable des ressources, assureraient la mise en œuvre opérationnelle et la sensibilisation.
- Les labels écologiques seraient garants de crédibilité auprès des investisseurs et des marchés internationaux.
La structure de gouvernance nationale pourrait prendre la forme d’un comité intersectoriel réunissant les ministères de l’Environnement, de l’Agriculture et des Finances. Ce comité serait épaulé par un tiers certificateur national ou adossé à une institution internationale. Une plateforme nationale des Crédits et Parts centraliserait le registre, la place de marché et les outils de transparence et garantirait la fluidité et la fiabilité des échanges.
Au-delà des acteurs institutionnels et opérationnels, le succès d’un marché marocain de la biodiversité dépendra également de sa capacité à mobiliser un écosystème diversifié d’investisseurs et de porteurs de Titres Nature :
- On y retrouve d’abord les investisseurs institutionnels — fonds, compagnies d’assurance, banques d’investissement — cherchant à intégrer des actifs verts crédibles et rentables dans leurs portefeuilles.
- Viennent ensuite les entreprises engagées dans des stratégies ESG ambitieuses, qui pourraient acquérir des Crédits ou Parts pour compenser leur empreinte ou valoriser leurs chaînes d’approvisionnement.
- Les fondations philanthropiques et fonds d’impact, quant à eux, apporteraient un capital patient destiné à soutenir des projets pilotes à fort potentiel écologique et social.
- Enfin, les particuliers et communautés locales pourraient être associés via des mécanismes participatifs, renforçant l’ancrage territorial et la légitimité des projets. En élargissant la base des porteurs de Titres Nature — Crédits et Parts —, le Maroc augmenterait la liquidité, la résilience et l’attractivité de ce nouveau marché.
Un scénario de déploiement
Les deux premières années pourraient servir au lancement de projets pilotes. Le lancement effectif de deux à trois projets dans des zones stratégiques — Rif oriental, Saïss, Oued Souss — permettrait, en effet, de tester les différents mécanismes financiers et de valider les standards de certification. Chaque projet servirait de laboratoire grandeur nature pour ajuster les procédures et former les acteurs locaux.
Les deux années suivantes, le Maroc pourrait mettre en place une Bourse verte marocaine dédiée à l’échange de crédits et parts biodiversité, facilitant l’accès des investisseurs nationaux et internationaux. Le Maroc serait alors progressivement intégré dans les mécanismes internationaux volontaires — le Global Biodiversity Framework, par exemple — afin de valoriser ses actifs naturels sur des marchés plus larges. Enfin, le royaume pourrait envisager de renforcer la traçabilité et la confiance grâce à une blockchain, assurant un suivi en temps réel des transactions et des impacts écologiques.
Nos deux premières chroniques de cette trilogie ont montré, d’une part, l’ampleur des besoins de financement pour protéger les écosystèmes marocains et, d’autre part, les outils concrets permettant de structurer un marché crédible et efficace de la biodiversité.
Elles ont également mis en évidence que la réussite de cette entreprise reposera autant sur la solidité technique des mécanismes que sur l’adhésion des acteurs locaux, nationaux et internationaux.
La troisième et dernière chronique de cette série s’intéressera à la dimension diplomatique et géopolitique des Marchés de la Nature. Nous verrons d’abord comment mettre en place un ensemble d’incitations fiscales, financières et réglementaires pour garantir le succès du marché marocain de la biodiversité. Puis, une fois ce socle consolidé, nous explorerons comment ce marché pourrait devenir un levier d’influence climatique, permettant au Maroc de bâtir des partenariats stratégiques en Afrique et de peser davantage dans les négociations internationales sur la nature et le climat.